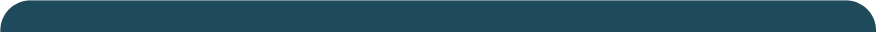EXTRAIT DE L'UN ET L'AUTRE DE VALERIE VILLATEL
Extrait du livre de Valérie Villatel, L'un et l'autre
Chapitre 1
Un cri aigu transperça le silence ; Jean regarda le ciel blanchi par le soleil au zénith et la lumière trop vive lui brûla les yeux. Au-dessus de lui, une buse tournoyait, décrivant un cercle parfait. Elle se rapprochait lentement, sans un seul bruissement d'ailes, simplement transportée par le courant favorable. Soudain, l'oiseau fit de nouveau résonner son appel strident. Quelques moineaux, dissimulés dans les branches des arbres voisins s’envolèrent, tandis qu'une brise légère souleva la chevelure argentée des vieux bouleaux. Jean s’étira et hissa sa canne à pêche qui, trop lourde, pour ses jeunes bras, retomba aussitôt. Près de lui, son frère s’était endormi à l’ombre d’un vieux chêne ; plus loin, sa sœur longeait l'étang à la recherche de plantes miracles, dont Jean ignorait l'usage. Elle scrutait le sol, protégée par un chapeau de paille, et avait remonté son tablier, de manière à confectionner un panier de fortune. Elle y déposait des herbes qu'elle coupait à l'aide de son canif.
Il y avait déjà trois ans que leurs parents étaient morts. Jean n’avait alors que huit ans. À l’époque, Victorine avait décidé de le garder auprès d’elle, à la ferme des « Hautbois », chez Maurice et Martha Barrault. Leurs parents y avaient été employés durant de nombreuses années et des liens d’amitié s’étaient tissés entre les deux familles ; surtout grâce à Joseph, le fils unique de la maison, qui éprouva, à l’âge des premiers amours, une forte attirance pour elle. Aussi, après quelques mois d’une cour assidue, leur destinée avait été scellée, par un gigantesque repas de fiançailles, où toute la métairie avait été conviée. La vie aurait pu suivre son cours, mais la guerre avait éclaté et Joseph s’était engagé. Sur le quai de la gare, il avait promis de revenir vite, mais les années étaient passées, sans plus de nouvelles. Bientôt, ce furent tous les hommes qui durent partir. Seules, les femmes se chargèrent des labours, pour qu’au retour de leur époux, il n’y ait pas trop de friche. Mais cela ne suffit pas à repousser le malheur, car Joseph ne revint pas. Déjà accablée par le chagrin, Victorine dut, néanmoins, affronter une autre épreuve. Son père, trop affaibli, par les gaz toxiques déversés dans les tranchées, mourut moins de trois mois après son retour. Sa femme n'eut ni la force ni le courage de cette nouvelle séparation et décida de le rejoindre six mois plus tard. Ainsi, sans jamais avoir commencé à vivre, Victorine s’était retrouvée mère et veuve à la fois. À tout juste vingt-cinq ans, elle en paraissait deux fois plus ; des rides profondes striaient son front et révélaient sa préoccupation continuelle. Son destin difficile et le poids des responsabilités l’empêchaient d’être tendre avec ses frères et, parfois, elle leur faisait payer chèrement son destin contraire. Néanmoins, pour ce geste, Jean et Henri lui vouait une grande reconnaissance. Mais puisque les bras manquaient à la ferme, Victorine avait décidé, qu’Henri devait aider aux champs. D’ailleurs, tout le monde considérait qu’il n’était pas fait pour étudier et qu'elle était avisée de le mettre au travail si rapidement. Pourtant, un soir, Jean avait compris qu’elle était dans l’erreur. Rentré plus tôt que d’ordinaire, il avait surpris Henri en train de lire. Bien sûr, Jean savait que Victorine ne verrait pas d’un bon œil de le trouver assis sans rien faire, mais il ne s’attendait pas à une si vive réaction, car en entrant, elle l’avait giflé.
« Où as-tu volé ce livre ?
— Je ne l’ai pas volé ! C’est à moi !
— À toi ? Et, dis-moi, comment as-tu fait pour le payer ?» avait-elle répliqué furieuse.
Il s’agissait d’un bel atlas de Géographie qui, s’il devait coûter fort cher, ne méritait pas autant de débats, aux yeux de Jean. Mais celui-ci lut tant de détermination dans le regard de son frère, qu’il sût que l’affaire était sérieuse, et lorsqu’une semaine plus tard, Jean le confondit un nouvel ouvrage à la main, il n’en fut pas vraiment étonné. Caché au fond de la grange, Henri lui avait seulement demandé de venir s’asseoir près de lui. Sans un mot de plus, il avait continué sa lecture à haute voix. Cependant, jamais Henri n’imagina, à quel point, ce témoignage de confiance, engagea la vie de Jean, car les livres qui, jusque-là, n’avaient jamais eu la moindre importance à ses yeux, lui, qui ne faisait pas un effort pour apprendre à lire, devinrent les symboles de cette connivence fraternelle. Pour Jean, cette période fut comme un nouveau départ ; qu’il pleuve ou qu’il neige, quelles que soient les demandes de sa sœur pour aider à la ferme, il se rendait à l’école. Le maître n’en revenait pas, et si chacun se demandait ce qui avait pu se produire pour qu’il change à ce point, rien n’était plus simple : il voulait ressembler à Henri. Ainsi, depuis ce jour, avant la tombée de la nuit, Jean le rejoignait à l’étable, où blotti dans ses bras, il l’écoutait lire le Combat Social. Henri vouait une admiration sans borne à Marx Dormoy, un socialiste de la région Bourbonnaise, dont il reprenait la plupart des idées. Il lisait tous les articles qu’il écrivait, retraçait tous ses discours au sein du Parti. Henri se réjouissait à chacune de ses victoires sur les communistes et ne prêtait jamais attention, aux rumeurs qui couraient en ville, sur les méthodes autoritaires qu’employait son mentor. Déjà, l’étrange prénom de son idole donnait la mesure du personnage. Pour Henri, Marx Dormoy représentait un modèle : il était fils de cordonnier et avait pour tout diplôme, le certificat d’étude ; malgré tout, à trente-deux ans, il prouvait que chacun avait sa chance. Seule, Martha avait été mise dans cette confidence. C’était elle, qui la première, avait permis à Henri d’emprunter les ouvrages scolaires de son fils Joseph, mais elle lui avait recommandé de ne pas ébruiter cette affaire, afin de ne pas provoquer la jalousie des autres ouvriers. Cependant, au bout de quelque temps, Victorine finit par se douter qu’il se passait quelque chose et remarqua, qu’à chaque fois, qu’elle tentait d’inculquer ses superstitions à Jean, Henri la ridiculisait par des explications savantes. Elle le questionna alors sur la provenance de toutes ces connaissances, mais jamais, Henri ne lui avoua quoi que ce soit, avant la remise de son diplôme.
Ce jour-là, Martha conduisit Victorine jusqu’à la place du village. Jean serrait fébrilement la main de sa sœur, inquiet de sa réaction. Ils arrivèrent à l’instant, où le maire et l’instituteur demandaient à Henri de les rejoindre sur l’estrade. À quinze ans, il avait une taille de plus que les élèves présents. Quand il reçut son certificat et un livre pour le récompenser, Victorine ne put empêcher ses larmes de couler, mais elle lui demanda quand même, ce qu’il comptait faire pour payer le reste de ses études. Tous ces souvenirs faisaient renaitre chez Jean, l'émotion de ce moment ; l'admiration qu'il avait pour son frère restait si vibrante, que ses yeux s'embuèrent malgré lui.
Jean croisa le regard sévère de sa sœur, totalement fermée au monde qui l'entourait, et devant sa moue stricte, n’osa rien lui demander. Il préféra s’asseoir face à Henri et attendre son réveil. Jean envia alors, le fin duvet qui commençait à recouvrir l’ourlet de ses lèvres, et même si ses bras oscillaient encore entre la finesse de l’enfance et les muscles du travailleur, là était la preuve, qu’Henri était devenu un homme. Soudain, les mouvements de sa respiration s’accélérèrent, des soubresauts nerveux secouèrent son corps, lui révélant ainsi, l'angoisse d'un rêve, derrière ses paupières closes. Jean hésita, puis tendit la main pour le réveiller, mais aussitôt, Henri se redressa et arrêta son geste. Il le fixait, droit dans les yeux, comme s’il ne le reconnaissait pas, effrayant Jean qui n'osait plus bouger. Lorsqu'en enfin, Henri remarqua le poisson pendu au bout de l’hameçon, il lui sourit. Mais une angoisse sourde lui serrait encore la poitrine ; une phrase, une seule, lui restait à l’esprit : « l’un ne va pas sans l’autre ». Pourtant, incapable d’en comprendre le sens, Henri laissa les mots disparaître de son esprit.
Sur la rive du Cher, Madeleine marchait aux côtés de son oncle, en regardant les cheminées des usines cracher leur fumée noire. Elle était arrivée, le matin même, et à neuf ans, elle avait déjà le sentiment d’avoir tout perdu. Elle venait de quitter sa ville natale d’Aubusson et, avec elle, le lien fragile qui l’unissait encore aux siens. Sa mère l'avait confiée à sa sœur Jeanne, pour qu’elle l’emporte vers un meilleur destin. Après la guerre, les métiers à tisser étaient demeurés silencieux. Il n'y avait plus de travail et les manufactures licenciaient à tour de bras. Tante Jeanne, tout juste mariée, avait décidé de suivre Marien, parti tenter sa chance à Montluçon, où Sir John Boyd Dunlop avait décidé de produire des pneumatiques. Les nouveaux ouvriers étaient logés dans une ancienne caserne désaffectée, à la périphérie de la ville, et pour effectuer les trois kilomètres qui les séparaient de la gare, la famille avait pris un âne pour porter leurs affaires.
Au pied des bâtiments, formant une cour carrée, Madeleine fut consternée par l’impression de désolation qui régnait. La cité était vide ; seule, une autre famille avait fait le voyage. Mais, lorsque la porte du nouveau logis s’était ouverte, et que le bruit sec de l’interrupteur fit jaillir une lumière jaune et fade, tous les yeux s’étaient illuminés.
« C’est immense ! s’exclama Tante Jeanne.
— Nous avons aussi l’eau ! Regarde Jeanne ! » s'émerveillait Oncle Marien.
Il s’était rapproché de l’évier et en faisait couler un mince filet. La fierté inondait son visage, tandis que sa femme restait médusée. Elle souriait, frottant fébrilement ses mains contre son tablier. Madeleine s’était rapprochée de la fenêtre et avait ouvert une persienne ; la cour plongée dans la pénombre renforçait son impression d’isolement. Au loin, elle avait remarqué la silhouette immense d’un vieil arbre, tandis que, derrière elle, Tante Jeanne répondait aux babils de son nouvel enfant ; elle l’avait prénommé Martin, mais Madeleine se forçait à n’y prêter aucune attention.
Au fil des mois, l’ancienne caserne se transforma en Cité ouvrière. Si la majorité des habitants venait des campagnes alentours, d’autres arrivaient de Pologne, d’Italie, d’Algérie et même du Sénégal. Désormais, les cours se distinguaient selon la provenance des habitants qui aménageaient des jardins en fonction de leurs origines. Bien entendu, le quartier avait mauvaise réputation, mais Madeleine s’était bien adaptée à sa vie nouvelle. Toutefois, les choses s’avérèrent plus difficiles pour Oncle Marien, car s’il n’était pas d’une nature méchante, la vie de l’usine était dure. Lui, qui tissait si habillement depuis son plus jeune âge, abîmait maintenant ses mains, dans la glue puante du caoutchouc. Alors, parfois, il buvait plus que de raison, et dans ces moments, il pouvait se montrer violent. Souvent, Madeleine se réfugiait sous le vieux chêne, près de la rivière, celui-là même, dont elle avait remarqué l’ampleur. Elle aimait s’allonger à l’abri de son ombre, et ne croyait nullement la légende, qui voulait que des âmes malheureuses hantent encore les lieux. Néanmoins, Tante Jeanne l’avertissait qu’elle finirait par attirer le mauvais œil si elle continuait à fréquenter cet endroit, mais au contraire, Madeleine prenait plaisir à l’effrayer, et prétendait même, qu’elle avait entendu pleurer. En réalité, cela en faisait le refuge idéal lorsqu’on la croyait à l’école, car personne ne se risquait dans les parages. Jules était le seul enfant du quartier qui osait s’aventurer jusqu’à l’arbre maudit. Il avait les cheveux blonds, presque blancs, et ses yeux d’un bleu translucide, lui donnaient parfois un air maladif. Le garnement avait le caractère aussi indépendant que le sien et c’était ce trait commun qui les avait rapprochés. Mais après la disparition de son père, l’humeur de Jules s’était mise à changer, et si Madeleine ignorait tout, des circonstances de sa mort, elle entendait souvent Tante Jeanne expliquer, que c’était bien malheureux. Alors, Madeleine lui tenait rarement rigueur de ses emportements inattendus, et faisait bon gré mal gré, avec son mauvais caractère ; jusqu’à ce jour, où Jules avait tenté de l’embrasser, par la force, sous le vieux chêne. Mais à la seconde où il s'était rapproché d’elle, une pierre l'avait frappé à la tempe. Instantanément, Jules avait chancelé, alors qu’un second projectile s’était abattu contre l’arbre. Jules s’était enfui, tandis que Madeleine restait paralysée. Elle entendait distinctement des bruits de pas et s’effrayait soudain de la parole des anciens quand, brusquement, une voix s’était élevée derrière elle : « Bouh ! »
Madeleine avait hurlé, tandis que Jean riait à gorge déployée.
« Eh ! J’suis pas un fantôme ! s’était-il exclamé pour calmer la jeune fille. Mais, celle-ci, tétanisée, ne savait plus s’il fallait le remercier.
— Laisse-moi ! avait-elle crié furieuse.
— Il faudrait savoir ce que tu veux ! avait-il ajouté, tandis qu’Henri les rejoignait les bras chargés des cannes à pêche. À sa vue, Madeleine s’était troublée :
— On se connaît ? lui avait-il demandé.
— Non », lui avait-elle simplement répondu.
Henri avait alors remarqué ses cheveux aux étranges reflets orangers, sa peau blanche presque laiteuse, qui laissait apparaître quelques taches de rousseur. Mais le plus surprenant était la couleur de ses yeux qui partait du gris pour aller jusqu’au vert. Elle avait quelque chose qui l’attirait et l’embarrassait à la fois, et lorsqu’elle l’avait fixé de nouveau, il s’était retourné, gêné par son insistance. Soudain, un grondement lointain avait annoncé l’orage et le vent avait plié le vieil arbre.
« Je dois partir, leur avait indiqué Madeleine.
— Oh, rien ne presse ! L’orage est encore loin ! » l’avait informé Jean.
Mais Madeleine ne voulait plus rester. Jean lui avait alors proposé de l’accompagner. Elle avait accepté, soulagée de s’éloigner de cet endroit damné.
Depuis ce jour, ils se virent si souvent que plus personne ne pouvait penser à Jean sans lui associer Madeleine. Ainsi, tant que l’enfance restât maîtresse de leur vie, personne ne s’opposa à leurs sentiments. Même Victorine laissa faire, jusqu’à ce que la féminité de la jeune fille devienne si flagrante, que la décence même, lui imposait de faire cesser cette relation. Depuis, Victorine restait sur ses gardes et tentait de faire comprendre à la jeune femme, qu’elle n’était plus la bienvenue. Madeleine prenait beaucoup trop d’importance dans la vie de ses frères. Passe encore pour Jean, qui devrait partir finir ses études. Il aurait bien l’occasion de l’oublier ! Mais, ce qui l’inquiétait plus, c’était qu’Henri se plaise, également, à la recevoir. Un jour, elle avait surpris son regard dévisageant l’impudente, et ce qu’elle y avait lu, était bien différent d’une simple bienveillance. Mais qui pouvait le blâmer ? À l’adolescence, les traits de la jeune fille s’étaient allongés. Ses joues avaient perdu leur rondeur et sa chevelure flamboyante soulignait ses grands yeux verts.
« Tout cela finira mal ! » disait-elle à chaque fois que Madeleine apparaissait.
Partagez sur les réseaux sociaux
Commentaires :Laisser un commentaire Aucun commentaire n'a été laissé pour le moment... Soyez le premier ! |
|
|